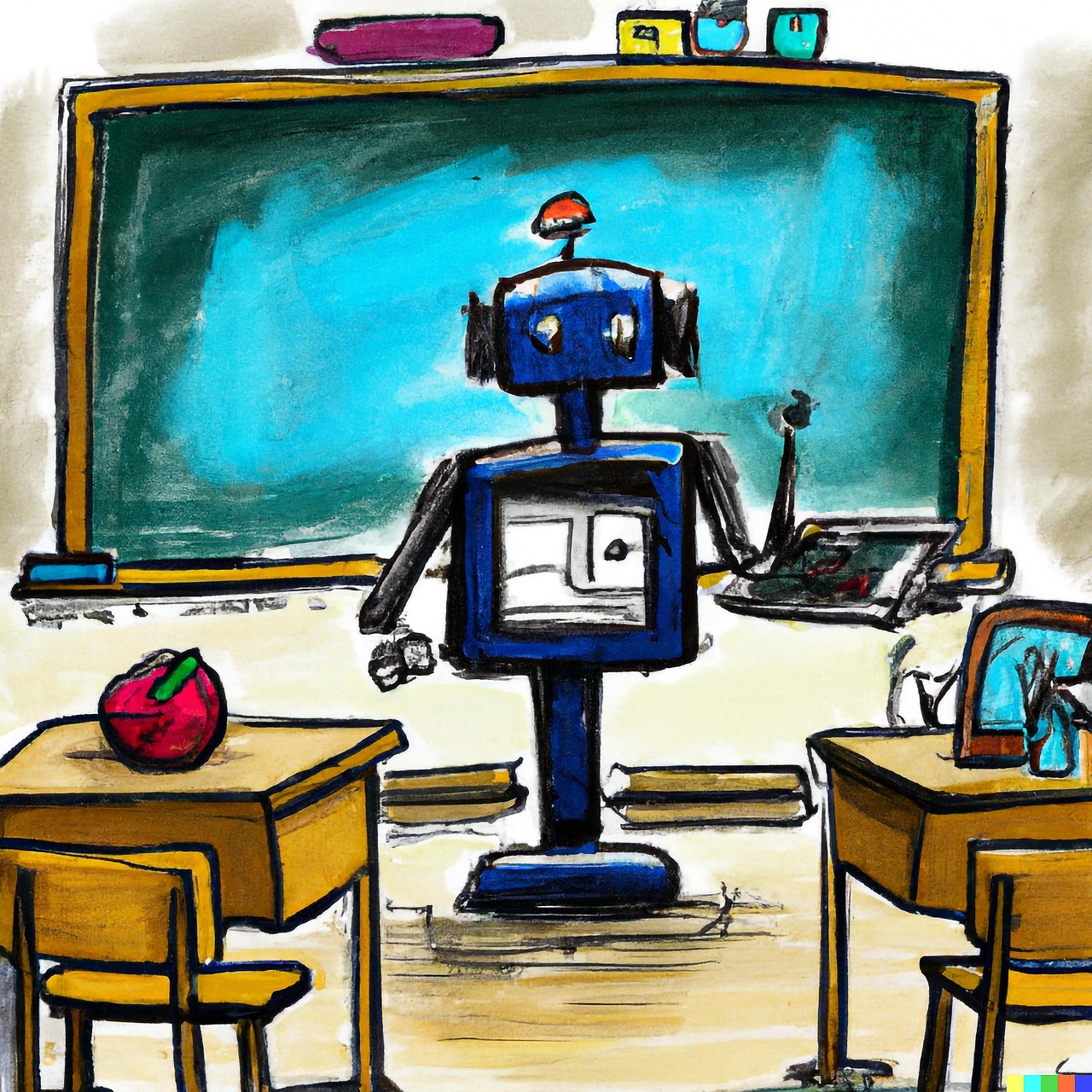
L’IA dans notre pratique : repenser notre processus de travail
Cet été, je me suis inscrite au cours The AI Fluency Lab, un parcours axé sur l’intégration réfléchie de l’intelligence artificielle en éducation. Je le poursuis module par module depuis juillet, et chaque étape m’amène à réfléchir différemment à ma méthode de travail et à l’accompagnement que j’offre au personnel enseignant.
Une phrase issue de ce module fait maintenant partie de mes réflexions lorsque j’utilise l’IA : si l’activité n’a pas besoin d’humanité, peut‑être qu’on peut la déléguer – ou la déléguer en partie – à l’IA.
Repenser notre processus de travail avec l’IA
Ce module invitait à analyser ce qui a réellement un impact dans notre travail. L’IA peut nous faire gagner du temps, oui, mais la vraie question devient : sur quoi souhaitons‑nous récupérer du temps ?
Par exemple, l’IA peut corriger des copies. C’est possible techniquement. Mais doit‑elle le faire ? Est‑ce qu’on gagnerait quelque chose à déléguer cette tâche ? Est‑ce qu’on perdrait quelque chose par rapport à la rétroaction personnalisée, au lien avec l’élève, ou à l’observation des difficultés récurrentes dans un groupe ?
Un autre exemple concret : la préparation de supports visuels pour une présentation. L’IA peut proposer une structure, un plan, des diapositives, du contenu ou des visuels. Dans certains cas, elle fait 80 % du travail et il reste 20 % d’ajustements pour que tout soit cohérent avec le contexte, le public et les intentions pédagogiques. Parfois, cela vaut la peine. D’autres fois, l’IA propose quelque chose qui ne reflète pas notre intention, notre ton ou notre compréhension du milieu… et on réalise qu’on aurait gagné du temps à tout faire soi‑même.
Il ne s’agit pas de juger ce qu’il « faut » déléguer ou non. Il s’agit de se demander : où investissons‑nous le mieux notre humanité ? Et qu’est‑ce que l’IA peut prendre en charge pour nous libérer du temps… afin de le consacrer à ce qui a réellement du sens ?
Choisir les bons outils pour les bonnes raisons
Le module distingue deux grandes catégories d’outils :
1. Les modèles généralistes (ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.)
Ils sont puissants, polyvalents et personnalisables. On peut créer des GPTs, des Gems ou des Agents pour répondre à des besoins précis. Ils demandent toutefois du temps de réflexion et de formulation pour obtenir exactement ce qu’on veut.
2. Les outils conçus spécifiquement pour le personnel enseignant (ex. : Magic School, Brisk, SchoolAI)
Ils fonctionnent comme des raccourcis : ils génèrent rapidement des plans de cours, des activités ou des évaluations. C’est pratique, mais cela peut faire perdre une partie de notre perspective pédagogique, puisque l’outil reflète son propre modèle et ses données.
L’idée n’est pas de choisir entre une catégorie ou l’autre, mais de trouver l’adéquation avec le contexte. Ce n’est pas l’outil qui rend l’intégration de l’IA réfléchie ; c’est l’intention derrière son utilisation.
L’IA pour voir plus large… ou plus en détail
L’IA a une capacité intéressante : elle peut s’adapter à l’échelle dont on a besoin. Elle peut prendre du recul pour offrir une vue d’ensemble, ou aller dans les détails très fins d’une tâche.
Cette flexibilité peut servir à rendre l’apprentissage plus pertinent pour les élèves : l’IA est très douée pour faire des analogies, établir des liens entre des concepts et créer des ponts avec les intérêts des élèves. Mais cette personnalisation n’a de sens que si nous connaissons réellement les élèves. L’IA ne sait pas ce qui importe pour un groupe donné ; elle ne fait que s’aligner sur ce qu’on lui demande.
C’est notre compréhension humaine qui donne un sens pédagogique au résultat.
Une nouvelle réflexion à garder en tête
Ce module n’était pas une invitation à « utiliser l’IA davantage », mais à l’utiliser mieux. Dans mon travail, je remarque déjà à quel point cette idée m’aide à décider si l’IA est utile ou non dans une situation :
- Si l’IA fait 80 % d’un travail satisfaisant et qu’il ne reste qu’à l’ajuster, c’est intéressant.
- Si l’IA fait 80 % d’un travail qui ne correspond pas à nos besoins, mieux vaut ne pas insister et faire autrement.
L’objectif n’est pas de tout automatiser. L’objectif est plutôt de récupérer du temps là où l’IA est pertinente… pour l’investir dans ce qui a vraiment de la valeur.
Je continue ce parcours un module à la fois, et je suis curieuse de voir quelles autres réflexions viendront transformer notre façon d’intégrer l’IA en éducation.
