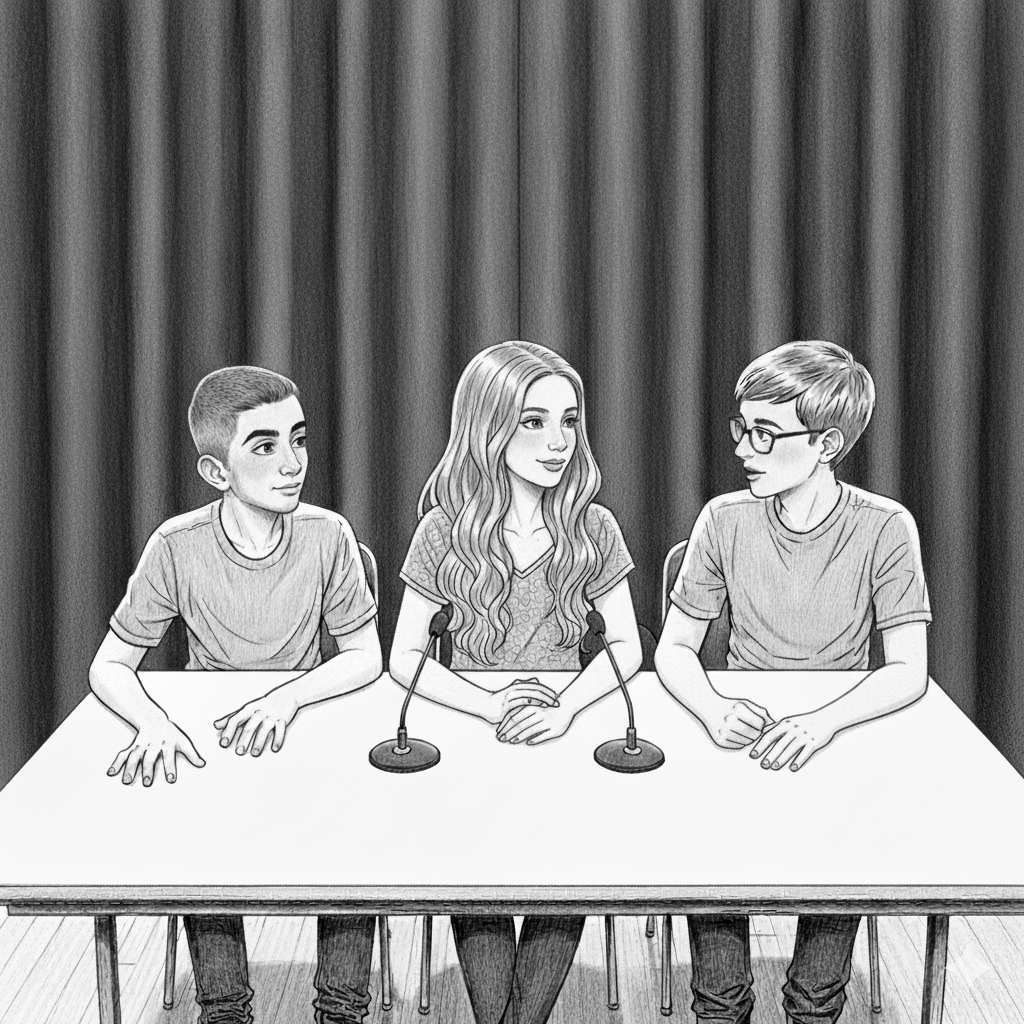
Et si on leur demandait leur avis ?
Ce que des étudiants du collégial m’ont appris sur l’IA et l’éducation
Il y a quelque temps, j’ai eu la chance d’assister à un panel de discussions où des étudiants du collégial étaient invités à partager leur rapport à l’intelligence artificielle (IA) dans leurs études. Ce n’était pas une formation, mais une discussion, mais je peux dire que c’est une des meilleures expériences d’apprentissage sur l’IA que j’ai eues dans les dernières années. Leurs témoignages m’ont profondément marquée et m’ont donné un éclairage concret sur l’intégration de l’IA dans l’éducation.
Une intégration déjà bien réelle
Pour ces étudiants, l’IA n’a rien de nouveau. Certains l’ont connue dès la cinquième secondaire et, depuis, elle fait partie de leur quotidien. Ils l’utilisent pour organiser leur horaire, gérer leurs travaux, clarifier des consignes ou encore générer des exercices pour réviser. Loin d’être accessoire, l’IA est devenue un soutien quotidien qui structure leur apprentissage. Ce qui m’a frappée, c’est leur rapport réfléchi à l’outil. Tous insistaient sur le fait qu’elle ne doit pas faire le travail à leur place : leur but reste d’apprendre, pas de tout déléguer.
Certains ont raconté qu’au départ, ils choisissaient de ne pas utiliser l’IA, par principe ou par valeurs éthiques, mais qu’ils ont vu d’autres étudiants en tirer un avantage concret. Peu à peu, ils ont essayé de l’intégrer à leur tour. Tous revenaient sur un point : tout déléguer à l’IA devient une tentation quand les tâches paraissent sans intérêt ou déconnectées, quand la charge est trop lourde, ou quand un retard s’accumule. Dans ces cas, certains élèves en arrivent à laisser l’IA faire entièrement le travail à leur place. Mais ils soulignaient que cette mauvaise utilisation est une solution temporaire : sur le long terme, elle prive de l’apprentissage réel et finit par nuire.
Comment on leur enseigne l’IA… et leur avenir professionnel
Lorsqu’ils ont abordé la pédagogie de l’intelligence artificielle, leur constat était clair : on leur parle beaucoup d’interdits, rarement des usages pertinents. Ce qu’ils souhaitent avant tout, c’est de la transparence : savoir ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, mais également voir leurs enseignants montrer comment eux-mêmes utilisent l’IA. Pour eux, apprendre à bien s’en servir fait partie intégrante de leur éducation. Ils pensent aussi déjà à leur avenir professionnel. Ils savent que l’IA fera partie du décor, peu importe le domaine. Oui, certains craignent des pertes d’emplois, mais la majorité y voit une opportunité : déléguer les tâches répétitives pour mieux se concentrer sur ce qui a une véritable valeur humaine. Leur demande est claire : qu’on les prépare dès maintenant à manier l’IA intelligemment, afin de se démarquer dans le futur.
Du sens et du lien
Au-delà de la technologie, c’est leur recherche de sens et de lien qui ressort. Ils veulent des cours vivants, des projets créatifs, des discussions qui nourrissent leur curiosité. Ils insistaient aussi sur l’importance d’avoir des classes actives, où la participation est valorisée, où l’on peut choisir des projets qui rejoignent ses intérêts, et où la curiosité est stimulée. Le lien avec leurs enseignants est pour eux essentiel : se sentir en confiance, poser des questions sans crainte, comprendre que l’erreur fait partie du chemin.
Ils aimeraient également que l’on parle davantage des enjeux éthiques et même environnementaux liés à l’IA, qui ont été très peu abordés dans leur parcours jusqu’à présent. Ils rappellent que leur génération devra être capable de s’adapter, de peut-être changer de carrière plusieurs fois au cours de leur vie professionnelle, et qu’ils ont besoin d’être outillés en ce sens : développer l’agilité, l’adaptabilité et les compétences relationnelles.
Repenser l’évaluation
Et puis, il y a la question de l’évaluation. À la question « comment pouvons-nous vous évaluer dans un monde avec l’IA ? », leur réponse était simple : observer le processus, pas seulement le produit final. Ils suggèrent de morceler les tâches, d’alléger la charge quand elle devient excessive et surtout de mieux coordonner les travaux entre les cours. Trop souvent, examens et travaux s’accumulent sans concertation, générant une pression énorme et alimentant la tentation de tricher. Ils ont expliqué que la facilité d’utiliser l’IA pour « s’en sortir » rapidement vient souvent de cette pression liée aux notes, à la peur de l’échec et au manque de temps. Selon eux, il faut ramener l’envie d’apprendre et non seulement viser la performance. Pour eux, il est urgent de sortir d’une culture de performance à tout prix et d’adopter une vision plus saine de l’échec comme étape d’apprentissage.
En quittant ce panel, une conviction s’est imposée à moi : nous devons écouter davantage les étudiants, les jeunes et tous ceux que nous accompagnons. Leurs demandes n’étaient pas irréalistes ou déconnectées, elles étaient au contraire pleines de sens et de réflexions pertinentes. Je crois que ce type de discussion devrait avoir lieu dans bien des milieux. Donnons-leur une place à la table, écoutons-les, et construisons avec eux l’éducation dont ils ont réellement besoin.
